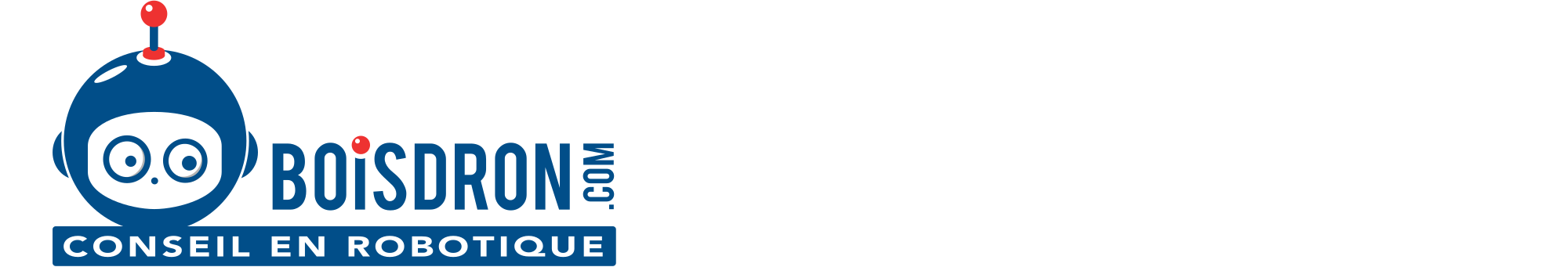Avec huit pays désormais contre la surveillance des messageries, l’Union européenne se fracture sur ce projet controversé que la France mène tambour battant.
L’Europe traverse une crise majeure autour de la surveillance numérique. Le 12 septembre 2025, l’Allemagne et le Luxembourg ont rejoint l’opposition au règlement européen contre l’abus sexuel d’enfants, surnommé « Chat Control » par ses détracteurs. Cette adhésion porte à huit le nombre de pays européens hostiles au projet, bouleversant l’équilibre des forces au sein du Conseil européen.
Proposé initialement en mai 2022 par la commissaire européenne Ylva Johansson, ce texte ambitieux vise à imposer aux plateformes numériques la détection obligatoire de matériel d’abus sexuel d’enfants. Concrètement, cette réglementation contraindrait tous les services de messagerie opérant en Europe à installer des « mouchards » dans leurs systèmes chiffrés pour scanner automatiquement les communications des utilisateurs.
La proposition danoise, actuellement débattue, prévoit un scanning directement sur l’appareil avant le chiffrement des messages. Cette surveillance ciblerait les URL partagées, les images et les vidéos échangées entre utilisateurs. Seuls les comptes gouvernementaux et militaires échapperaient à cette mesure de contrôle généralisé.
La France à la tête d’une coalition pro-surveillance
La France se positionne comme le leader du groupe majoritaire favorable à cette surveillance de masse. Cette position s’inscrit dans une longue tradition hexagonale de mise sous surveillance de la population, accélérée depuis les années 2000. Dès l’époque où Nicolas Sarkozy était ministre de l’Intérieur, la France a commencé à déployer des systèmes de surveillance massive, légalisés une décennie plus tard.
Le pays possède une expertise reconnue dans le domaine de la surveillance numérique, étant devenu l’un des principaux marchands d’armes civiles sur la planète. La France propose aujourd’hui la plus importante plateforme mondiale pour l’achat de failles de sécurité informatique, régulées exactement comme l’armement traditionnel par les arrangements de Wassenaar.
Cette approche volontariste tranche avec la position allemande. Le ministère fédéral de l’Intérieur allemand a explicitement déclaré son opposition à « la rupture du chiffrement« , invoquant l’expérience historique de la Stasi. Cette mémoire douloureuse de la surveillance totalitaire influence encore aujourd’hui les positions allemandes sur ces questions sensibles.
Une coalition d’opposition qui s’étoffe malgré tout
Désormais, huit pays européens s’opposent fermement au projet : l’Allemagne, le Luxembourg, l’Autriche, la Belgique, la République tchèque, la Finlande, les Pays-Bas et la Pologne. Les Pays-Bas justifient leur opposition par l’incompatibilité fondamentale du texte avec la Convention européenne des droits de l’homme, une évidence que peu d’autres États semblent remarquer.
Néanmoins, quinze États membres soutiennent toujours activement la proposition française. Seuls quatre pays restent indécis : l’Estonie, la Grèce, la Roumanie et la Slovénie. Cette répartition illustre la profonde division qui traverse l’Union européenne sur cette question cruciale pour l’avenir des libertés numériques.
L’adhésion allemande à l’opposition pourrait faire basculer définitivement le rapport de forces. L’entreprise allemande Tuta Mail, spécialisée dans la messagerie chiffrée, salue cette décision et menace de poursuivre l’Union européenne si le projet aboutit. Son PDG souligne que protéger les communications privées s’avère essentiel pour sauvegarder la démocratie et la liberté d’expression.
Un projet technique aux failles béantes

L’efficacité technique du projet soulève pourtant de sérieuses interrogations. Plus de 500 scientifiques et chercheurs en cryptographie ont dénoncé la proposition européenne, qualifiant les arguments techniques de « poudre aux yeux« . Cette opposition scientifique massive révèle l’impossibilité pratique de scanner efficacement les contenus sans générer un taux d’erreur prohibitif.
En Irlande, les statistiques confirment ces craintes : seulement 20,3% des signalements reçus par les forces de police correspondent effectivement à du matériel d’exploitation. Plus inquiétant encore, 11,2% des cas sont classés comme faux positifs. Ces données illustrent les limites actuelles des technologies de détection automatique et les risques d’une surveillance généralisée inefficace.
Le Parlement européen a commandé une étude d’impact supplémentaire qui critique sévèrement la proposition de la Commission. Selon cette analyse, aucune solution technologique existante ne permet de détecter le matériel d’abus sans compromettre fondamentalement la sécurité des communications numériques pour tous les utilisateurs.
Un prétexte classique pour une surveillance de masse
Le projet Chat Control s’inscrit dans une stratégie plus large de contrôle des communications privées. L’argument de la protection de l’enfance, bien que légitime dans son principe, sert souvent de prétexte pour justifier des mesures disproportionnées de surveillance. Cette tactique n’est pas nouvelle et s’observe dans plusieurs pays occidentaux confrontés à des défis similaires de contrôle de l’opinion publique.
Le texte vise particulièrement le « dark social », cet espace numérique constitué par les messageries privées échappant à toute surveillance extérieure. Contrairement aux réseaux sociaux publics comme Twitter, ces espaces de communication permettent des échanges confidentiels entre citoyens, notamment lors de crises ou de mobilisations sociales.
La mise en place de Chat Control compromettrait définitivement le secret des sources journalistiques, rendant impossible le travail d’investigation indépendant. Cette perspective devrait alarmer les professionnels de l’information, pourtant étrangement silencieux sur cette question cruciale pour l’avenir de leur métier.
Une accélération révélatrice sous la présidence Macron
L’actuelle période se caractérise par une accélération sans précédent des projets de surveillance et de censure. Cette précipitation révèle une perte de contrôle progressive de l’opinion publique par les dirigeants traditionnels. Le Digital Services Act (DSA), déjà en application, complète ce dispositif en institutionnalisant la censure via des « signaleurs de confiance ».
Les associations comme SOS Racisme, le CRIF, la Licra ou Osez le Féminisme jouent un rôle clé dans la signalisation des contenus. Elles ont un pouvoir décisif sur ce qui est supprimé ou conservé en ligne.
Ce système repose sur une sélection politisée, susceptible d’évoluer avec les changements de majorité.
Il pourrait ainsi devenir un outil de censure, ajusté aux idéologies du gouvernement en place.
La situation devient particulièrement préoccupante dans la perspective d’un changement politique majeur. Les outils actuels de surveillance et de censure forment un système prêt à l’emploi.
Il offre aux futurs dirigeants un pouvoir totalitaire, facile à exploiter. Ils pourront l’utiliser pour servir leurs propres objectifs politiques.
Un calendrier législatif sous haute tension s’annonce. Lors du Conseil du 12 septembre 2025, les États membres ont arrêté leurs positions. Une nouvelle réunion est prévue le 14 octobre avec les ministres de la Justice européens. L’opposition récente de l’Allemagne menace désormais le projet. Or, la France le défend avec une détermination qui trahît ses ambitions en matière de surveillance numérique.
Mais cette résistance tardive suffira-t-elle à préserver les derniers espaces de liberté dans l’Europe de demain ?
Illustration en Une générée par Flux AI.
Source : France Info.
Sur le même sujet
FAUT-IL AVOIR PEUR DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ? – Définitions de l’IA [ERVLF #47]