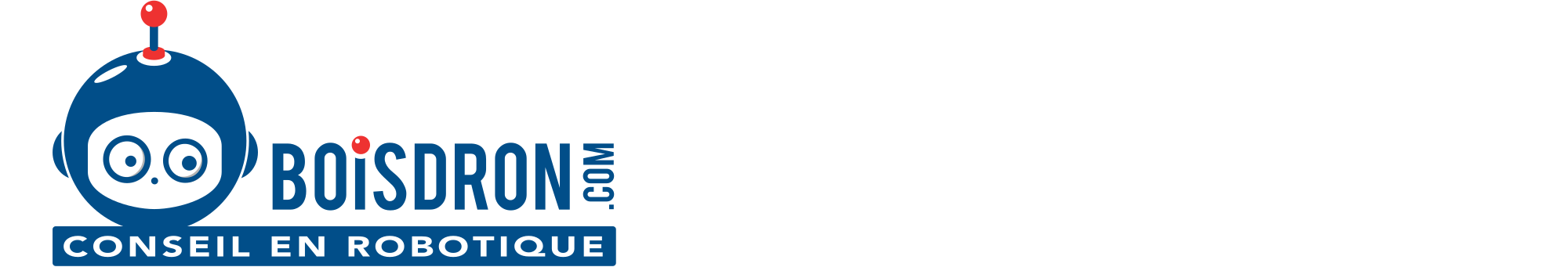Lors de l’assemblée annuelle des actionnaires Tesla, Elon Musk a évoqué la possibilité de télécharger l’esprit humain dans ses robots Optimus d’ici moins de 20 ans. Une promesse d’immortalité qui soulève une question scientifique majeure : même si cette prouesse technique devenait réalisable, l’original finit par disparaître quand même.
Elon Musk n’a jamais manqué d’audace dans ses prédictions futuristes. Le 17 novembre 2025, lors de l’assemblée annuelle des actionnaires Tesla à Austin, le milliardaire a franchi un nouveau cap dans ses déclarations visionnaires. Face à un actionnaire lui demandant si Optimus pourrait un jour abriter une conscience humaine, le PDG de Tesla n’a pas éludé la question. Au contraire, il a détaillé sa vision avec une précision déconcertante.
« Ce n’est pas immédiat », a-t-il d’abord nuancé avant de développer son idée. Selon lui, grâce à Neuralink, sa société d’interfaces cerveau-machine, il serait possible de créer un instantané approximatif de l’esprit d’une personne. Cet instantané pourrait ensuite être téléchargé dans le corps d’un robot humanoïde Optimus. Le calendrier annoncé ? Moins de vingt ans. Musk a même ajouté une touche philosophique en comparant ce processus aux changements naturels de notre personnalité : « Êtes-vous la même personne qu’il y a cinq ans ? Non. »
Cette déclaration s’inscrit dans la continuité des ambitions transhumanistes du milliardaire. Les robots Optimus, dévoilés progressivement par Tesla, sont présentés comme l’avenir de l’humanité. Lors de ce même meeting, Musk a affirmé que chaque humain pourrait posséder son propre robot humanoïde, et que des dizaines de milliards d’unités pourraient être produites. Le transfert de conscience dans ces machines représenterait l’étape ultime de cette vision : l’immortalité numérique.
Un cerveau impossible à cartographier complètement
La première difficulté majeure réside dans la complexité inouïe du cerveau humain. Les neuroscientifiques estiment que notre cerveau contient environ 86 milliards de neurones et 85 milliards de cellules non neuronales. Ces neurones établissent entre eux un million de milliards de connexions synaptiques. Pour donner une échelle de comparaison, la Voie lactée compte environ 200 milliards d’étoiles. Le cerveau humain est donc infiniment plus complexe que notre galaxie.
Les avancées technologiques en imagerie cérébrale, comme l’IRM fonctionnelle, permettent certes de progresser dans la cartographie du cerveau. Des projets ambitieux comme le Human Brain Project, lancé en 2013 par l’Union européenne, ont contribué à mieux comprendre les réseaux neuronaux. Toutefois, ces progrès restent limités. Actuellement, les scientifiques sont parvenus à cartographier le cerveau d’une mouche, qui possède environ 3 000 neurones et 500 000 connexions. Selon les estimations, il faudrait encore une décennie pour cartographier celui d’une souris.
La difficulté ne s’arrête pas à la cartographie structurelle. Il faudrait également enregistrer chaque neurone en action pour reproduire son fonctionnement dynamique. Le cerveau intègre et compresse de multiples composants d’une expérience : la vue, l’odorat, le toucher, les émotions. Comme l’explique Subhash Kak, professeur à l’Université d’Oklahoma, ces éléments ne peuvent être gérés de la manière dont les ordinateurs détectent, traitent et stockent les données. Un ordinateur ne fonctionne tout simplement pas comme un cerveau biologique.
Le mystère irréductible de la conscience

Au-delà des défis techniques se pose un problème encore plus fondamental : la nature de la conscience elle-même. Le philosophe David Chalmers a identifié ce qu’il appelle le « hard problem » de la conscience. Comment l’activité électrochimique du cerveau génère-t-elle notre expérience subjective du monde ? Cette question reste l’un des plus grands mystères de la science moderne. Comprendre pourquoi nous ressentons quelque chose plutôt que d’être simplement des machines qui réagissent aux stimuli demeure une énigme.
Le neurobiologiste Antonio Damasio souligne que « la conscience n’est pas uniquement une question d’information, mais aussi d’expérience incarnée ». Cette dimension corporelle de la conscience pose un défi de taille. Notre expérience consciente n’émerge pas seulement de notre cerveau, mais de l’interaction complexe entre notre système nerveux et notre corps tout entier. Des neuroscientifiques de l’Université de Princeton vont plus loin en affirmant que le modèle cerveau-ordinateur obscurcit les propriétés physiques complexes du cerveau, notamment les propriétés émergentes.
Ces propriétés émergentes sont des caractéristiques qui apparaissent au fur et à mesure qu’un système fonctionne, mais qui ne peuvent être prédites uniquement à partir de l’étude de ses composants. La conscience serait justement l’une de ces propriétés émergentes. Même si nous parvenions à simuler chaque neurone individuellement, rien ne garantit que la conscience émergerait de cette simulation. Ce serait comme essayer de recréer une symphonie en listant toutes les notes une par une, sans comprendre l’harmonie qui les unit.
Une copie n’est pas l’original
Voici le paradoxe le plus troublant de la proposition de Musk : même si la technologie permettait de copier parfaitement votre conscience dans un robot Optimus, vous ne seriez pas immortel. Cette copie serait une entité distincte qui partagerait vos souvenirs et votre personnalité à l’instant du transfert. Mais vous, l’original, mourriez quand même. Le philosophe britannique Derek Parfit a exploré ce paradoxe à travers l’expérience de pensée du téléporteur de Star Trek.
Imaginez un appareil qui scanne votre corps au niveau atomique, le détruit, puis transmet ces informations à Mars où une machine vous reconstitue à l’identique. La personne sur Mars aurait tous vos souvenirs, votre personnalité, votre façon de penser. Mais serait-ce vraiment vous ? Ou plutôt un clone qui croit être vous ? Pour Parfit, il n’y a pas de réponse absolue. Ce qui importe, c’est la « connectivité psychologique ». Cependant, cette position philosophique n’efface pas la réalité troublante : l’original a cessé d’exister.
Le neuroscientifique Randal Koene, qui travaille sur l’émulation totale du cerveau, reconnaît lui-même cette limite. Une copie de votre cerveau pourrait avoir conscience de soi, manifester de l’humour ou de l’empathie. Elle se comporterait exactement comme vous. Mais elle ne serait pas vous, juste une instanciation numérique de votre esprit. La continuité de votre expérience subjective, ce fil qui relie votre passé à votre présent, serait brisée. Votre conscience ne « passerait » pas dans le robot. Elle y serait dupliquée, pendant que vous, dans votre corps biologique, cesseriez d’exister.
Une promesse technologique qui ignore la science
Les déclarations de Musk s’inscrivent dans une longue tradition transhumaniste qui promet de vaincre la mort par la technologie. Des entrepreneurs milliardaires comme le Russe Dmitry Itskov, avec son Initiative 2045, poursuivent des objectifs similaires depuis des années. Pourtant, la communauté scientifique reste profondément divisée sur la faisabilité de ces projets. Certes, des chercheurs comme Douglas Hofstadter, Christof Koch ou Marvin Minsky admettent la possibilité théorique du téléchargement de conscience. Mais beaucoup d’autres restent catégoriques : créer un ordinateur ayant la conscience d’un être humain restera impossible.
Les chercheurs qui étudient ces questions soulignent une distinction cruciale souvent négligée : on ne cherche pas à « transférer » la conscience, mais à « reproduire une activité de la conscience sur une machine ». Comme l’explique le chercheur Alexis Tsoukias, on émet des hypothèses sur ce qu’est l’apprentissage et on essaie de le reproduire sur une machine. La machine n’a pas de conscience propre. Elle simule des processus cognitifs, mais elle n’éprouve rien au sens propre. C’est la différence fondamentale entre imiter et être.
Le délai de vingt ans annoncé par Musk semble également optimiste, voire irréaliste. Si cartographier le génome humain a nécessité des années et des centaines de millions de dollars il y a vingt ans, l’opération ne coûte aujourd’hui que 100 dollars. Mais le cerveau est infiniment plus complexe qu’un code génétique. Il ne s’agit pas seulement de lire une séquence d’information, mais de comprendre comment cette information donne naissance à l’expérience consciente. Un saut technologique qui dépasse largement la simple amélioration de la puissance de calcul.
Alors, que penser de la promesse d’Elon Musk de télécharger notre conscience dans un robot Optimus d’ici 2045 ? Les avancées en neurosciences, en intelligence artificielle et en interfaces cerveau-machine sont réelles et impressionnantes. Peut-être parviendrons-nous un jour à créer des copies numériques suffisamment sophistiquées pour être indiscernables de l’original. Mais ces copies ne nous offriront pas l’immortalité. Elles créeront simplement de nouvelles entités qui croiront être nous, pendant que nous, les originaux, continuerons de vieillir et de mourir. La question demeure : est-ce là une forme d’immortalité qui vaut la peine d’être poursuivie, si ce n’est qu’un autre vous qui en profite ?
Source : Meeting annuel Tesla